Pour les organisations qui opèrent dans ou avec l'Union européenne, il est essentiel de comprendre comment les lois sur la confidentialité des données s'entrecroisent à travers les frontières. Pourtant, le CLOUD Act américain continue de semer la confusion quant à la signification pratique de la souveraineté numérique.
Ce blog explique les principales implications du CLOUD Act, pourquoi il est en contradiction avec les principes européens de protection des données tels que le GDPR, et ce qu'il signifie pour les entreprises qui tentent de protéger leurs communications sensibles.
Qu'est-ce que la loi CLOUD ?
Le CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) est une loi fédérale américaine adoptée en 2018. Elle permet aux forces de l'ordre américaines de contraindre les entreprises américaines à donner accès à des données stockées à l'étranger, même si ces données appartiennent à des personnes non américaines et résident dans des centres de données situés dans l'Union européenne.
Cela inclut les fournisseurs de services en nuage "souverains" comme Microsoft :
- les fournisseurs de cloud "souverains" tels que Microsoft, Google et Amazon
- Les outils de communication comme Teams ou Slack
- Toute plateforme américaine stockant des données à l'échelle mondiale.
Que fait le CLOUD Act ?
Le CLOUD Act l'emporte sur les lois locales en matière de protection des données lorsque des enquêtes criminelles impliquent des intérêts américains. Son champ d'application est extraterritorial, ce qui signifie qu'il s'applique quel que soit l'endroit où les données sont physiquement stockées, dès lors que le fournisseur de services est basé aux États-Unis. Il donne aux autorités américaines le pouvoir d'accéder à des données personnelles, à des données d'entreprise ou même à des données classifiées avec un mandat, sans notification préalable aux utilisateurs concernés ou aux régulateurs européens.
Comment le CLOUD Act affecte-t-il le GDPR ?
C'est là que le conflit commence.
En vertu du GDPR, les transferts de données en dehors de l'UE nécessitent une base juridique. L 'article 48 du GDPR stipule que les ordonnances judiciaires émanant de pays tiers (comme les États-Unis) ne sont valables que si elles sont fondées sur un accord international tel qu'un traité d'entraide judiciaire (MLAT). Or, le CLOUD Act contourne complètement les MLAT.
Les entreprises sont donc confrontées à un dilemme juridique :
- Si elles se conforment à un mandat américain, elles risquent d'enfreindre le GDPR.
- Si elles refusent, elles s'exposent à des sanctions juridiques aux États-Unis.
Le Comité européen de protection des données a été très clair : les fournisseurs de services soumis à la législation de l'UE ne peuvent légalement fonder les transferts de données vers les États-Unis uniquement sur les demandes formulées dans le cadre du CLOUD Act.
Qu'y a-t-il de nouveau ou d'unique dans le CLOUD Act ?
Contrairement aux mécanismes antérieurs tels que le MLAT, le CLOUD Act n'exige pas de coopération entre les gouvernements. Il donne aux autorités américaines un accès unilatéral aux données, sans exiger de contrôle judiciaire dans l'UE, ni de recours juridique suffisant pour les personnes concernées de l'UE.
Bien qu'une disposition permette aux fournisseurs de services américains d'annuler ou de modifier une demande si elle est contraire à une loi étrangère, cette option est rare, complexe et discrétionnaire. Dans la plupart des cas, elle n'empêchera pas le transfert de données européennes.
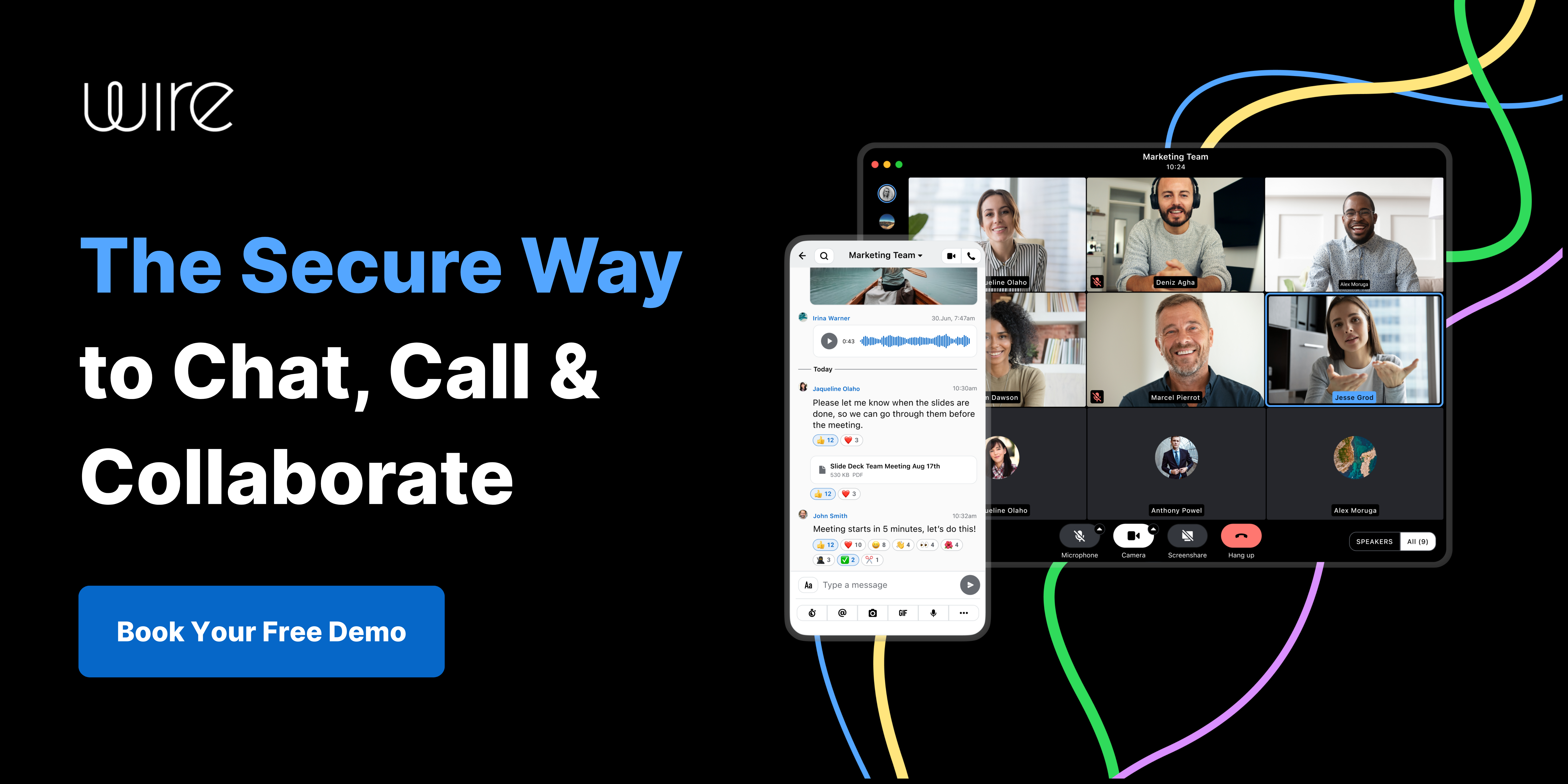
Quelles sont les conséquences pour les entreprises européennes ?
À première vue, une entreprise américaine peut promettre que vos données "ne quitteront jamais l'UE". Mais en vertu de la loi CLOUD, la localisation n'a plus d'importance. La juridiction suit la propriété.
Ainsi, même si les données sont hébergées à Francfort ou à Paris, si elles sont gérées par un fournisseur basé aux États-Unis, les autorités américaines peuvent légalement y accéder, sans que l'utilisateur ou une autorité publique européenne ne soit impliqué. Cela va directement à l'encontre des principes de transparence et de consentement du GDPR :
- les principes de transparence et de consentement duGDPR
- l'arrêt Schrems II, qui a invalidé le cadre du bouclier de protection des données (Privacy Shield)
- laconfiance dans les revendications de "nuage souverain" des entreprises technologiques américaines.
Lorsque les forces de l'ordre américaines émettent de telles demandes, les entreprises et les fournisseurs de services européens ne doivent pas s'y conformer directement. Ils doivent plutôt soumettre ces cas au traité d'entraide judiciaire (MLAT), qui prévoit des garanties procédurales plus solides et une sécurité juridique en vertu du droit de l'UE. À moins qu'un mandat délivré dans le cadre du CLOUD Act ne soit rendu exécutoire par le MLAT et reconnu par le GDPR, il n'existe pas de base légale pour la transmission de données à caractère personnel de l'UE.
Pour les entreprises qui traitent des informations sensibles, qu'il s'agisse de secrets commerciaux ou de données personnelles de clients, ce conflit juridique crée un risque réel. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises ne se concentrent plus sur l'endroit où les données sont stockées, mais sur la personne qui contrôle l'infrastructure. Si le fournisseur relève de la juridiction américaine, la conformité totale au GDPR ne peut être garantie. C'est pourquoi le choix d'un fournisseur basé dans l'UE n'est pas seulement une préférence. C'est une nécessité pour la protection des données et la souveraineté.
Loi CLOUD vs. GDPR : Une collision juridique
Le GDPR a été conçu pour protéger les droits des individus à la vie privée et à la protection des données au sein de l'UE. Il impose des règles strictes sur la manière dont les données peuvent être traitées, stockées et transférées, en particulier au-delà des frontières.
La loi CLOUD contourne ces règles en
- en autorisant la portée extraterritoriale de la législation américaine
- n'exigeant pas de contrôle judiciaire dans le cadre des systèmes juridiques de l'UE
- ne prévoit pas de recours juridiques adéquats pour les citoyens de l'UE.
Les organisations se trouvent donc dans une situation délicate : se conformer au GDPR et risquer d'enfreindre le CLOUD Act, ou se conformer aux citations à comparaître américaines et risquer les sanctions prévues par le GDPR.
Revendications de "nuage souverain" : Marketing ou réalité ?
De nombreux fournisseurs internationaux proposent désormais des centres de données et des services basés dans l'UE et présentés comme "souverains". Mais la souveraineté ne se limite pas à l'endroit où les données sont stockées, elle concerne également la personne qui les contrôle.
Si un fournisseur de services en nuage a son siège aux États-Unis, le CLOUD Act s'applique toujours. C'est le cas de
- Microsoft 365 "EU Data Boundary" (frontière de données de l'UE)
- Le "nuage souverain européen" d'Amazon
- Les "contrôles souverains" de Google
Ces offres donnent l'illusion d'un contrôle, tout en restant soumises aux exigences de la législation américaine.
Que doivent faire les organisations européennes ?
Si votre organisation a besoin d'assurer une véritable souveraineté numérique et la conformité, envisagez les mesures suivantes
- Le chiffrement côté client: Gardez les clés de chiffrement sous votre contrôle afin que personne, pas même le fournisseur, ne puisse accéder à vos données.
- Des plateformes à code source ouvert, appartenant à l'UE: Choisissez des outils européens dont la technologie et la société résident dans des juridictions conformes à vos exigences de conformité.
- Architectures fédérées à confiance zéro: Limitez l'accès à vos systèmes et décentralisez le contrôle dans la mesure du possible.
Pour des secteurs tels que la santé, la défense, l'administration et la finance, ces mesures sont essentielles pour protéger les communications sensibles et maintenir la conformité légale.
En résumé
Le CLOUD Act introduit un conflit réel et non résolu pour les organisations de l'UE qui utilisent des fournisseurs de services basés aux États-Unis. Il contourne les cadres juridiques européens et remet en cause l'idée même de souveraineté des données.
Si votre fournisseur est soumis à la juridiction américaine, vos données peuvent ne pas être en sécurité, même si elles sont stockées dans l'UE. La souveraineté n'est pas un argument marketing, c'est une réalité juridique.
Le véritable contrôle commence par le choix d'une infrastructure alignée sur votre environnement juridique. Il s'agit de plateformes européennes, à code source ouvert et sécurisées sur le plan juridictionnel, comme Wire.
